

Entre les transparences aux reflets hyalins, la vie éclot, croît, grouille et se laisse observer. Tantôt de chair, tantôt de vent, ce qui enclot à la fois cultive, protège et étouffe. Le vivarium est l’enceinte dans laquelle on veut surveiller, faire vivre, profiter. Il faut beaucoup de sensibilité, de présence et de patience pour écouter ce qui pousse – vers le haut, vers le bas, et aussi de travers.
À la fois observatrice soucieuse et petit insecte au cœur des cotylédons, la création nécessite un environnement spécifique pour s’élaborer, déborder, se rendre jusqu’à autrui. Ne s’apparente-t-elle pas parfois elle-même au vivarium, cet artifice qui imite la nature tout en la limitant, cette frontière qui empêche les corps, mais excite l’imagination ?
Ventre rond, voilier en mer, jardin clos abritant des occupant·e·s à longues pattes, nouveau-né sans cesse menacé, souvenirs omniprésents, bagage de goéland, les manifestations du vivant incubé, transporté, chéri et souvent étouffé sont constitutives du quotidien. Si le vivarium est le terreau permettant à l’amour de l’autre (Hasnaa Zebeir, Nadeau, St-Amand, Desmeules) et de soi (Lamarche, Lamanque) de prendre racine et fleurir, il est aussi la trace de dominations sociales et économiques (Bissonnette, Moreau). Or le plus souvent, il est une invitation à développer l’acuité, la considération (Boudreau, Lévesque) de ce qui croît, ce qui tente d’exister sous nos yeux, voire malgré nos yeux.
Les œuvres visuelles rassemblées explorent quant à elles le dispositif du vivarium et en observent les dynamiques du regard, entre transparence et opacité. Elles en actualisent la forme pour contempler la vie du compost (Racine), réfléchir à l’habitabilité de l’image (Bauer) ou décortiquer la vie de la création (Martineau). Elles métamorphosent l’architecture de verre du vivarium en un corps de chair et de souffle (D. Gagné) ou en un vertigineux kaléidoscope de projections vidéo qui, à l’inverse, camoufle les corps (Acosta et Tavera).
Enfermement et permission, aliénation et potentialité, le vivarium nous interpelle bien au-delà de ses parois – et de ces pages. Pour le saisir, ou du moins l’appréhender, tendons l’oreille et ouvrons l’œil. Qui sait si l’on n’est pas regardé·e en retour ?
Auteur·rice·s : James Bissonnette, Geneviève Boudreau, Maxime Desmeules, Maya Hasnaa Zebeir, Jennie Lamanque, Sarah Lamarche, Aimée Lévesque, Annabelle Moreau, Maude Nadeau, Karolann St-Amand
Artistes : Laura Acosta et Santiago Tavera, Lorna Bauer, Rosalie D. Gagné, Luanne Martineau, Antoine Racine
Ancrages : Geneviève Thibault
Entretiens : Alexie Morin (Anne-Marie Duquette) et Maria Simmons (Noémie Fortin)

Il faut de l’air pour déployer les possibles; c’est ce que propose de dégager ce numéro, une pression atmosphérique qui dépasse tous les baromètres, qui transcende les corps, qui se meut et s’immobilise à la fois.
Entre les lieux publics et le chez-soi s’étirent de nombreux espaces de passage, de suspens, qui épongent les débordements ou, au contraire, leur permettent de se déployer. Couvent, hôpitaux, ascenseurs, littérature, chambres d’hôtel, ces lieux banals et à la fois révélateurs, réfléchissent, voire exacerbent les parts de soi mal-aimées. Ce mouvement et ce temps, qui relèvent non du pas de recul mais du pas de côté, permettent au regard d’envisager l’existence et l’autoréflexivité sous un nouvel angle.
Ils multiplient la linéarité de la trajectoire d’une vie, offrant parfois des choix, parfois un passage obligé non anticipé. Ce regard différent, décalé, peut s’exercer sur soi (Boutin, Lamy, Rose), sur la relation d’autrui avec soi (Frenette-Vallières, Deslauriers, Wagenfuhrer), ou sur une figure si marquante qu’elle intervient sur le soi (Lord, Moeder). Il peut également se poser sur un rapport au lieu, tantôt ouvert (Deland), tantôt clos (Readman Prud’homme), ou encore sur la matière à créer (Pleau).
Certains lieux et espaces sont enclins à favoriser des états d’instabilité, de fragilité et de précarité. Parier sur la valeur d’objets, à la manière des marchés boursiers, mène à des spéculations et à des fluctuations économiques auxquelles il convient de réfléchir (Roussel, Williams). Des mises en spectacle au sein de la sphère publique activent la transgression (André, Adair Mckenzie) ou le cheminement d’un état à un autre (Arès).
Ce numéro invite à réévaluer les vacillements pour mieux comprendre, par la suite, la certitude.
*Erratum : Les crédits à la page 69 ont malheureusement été inversés. Le regroupement d'oeuvres du haut sont des photogrammes tirés de la vidéo installative du projet « Special creatures » ; les photographies sont d'Andrée-Anne Roussel. Les oeuvres du bas sont des vues de l’exposition à OBORO 2025 ; les photographies sont de Michael Patten.
Auteur·rice·s : Sarah Boutin, Myriam Coté, Monique Deland, Camille Deslauriers, Andréane Frenette-Vallières, Clara Lamy, Elizabeth Lord, Claire Moeder, Michel Pleau, Camille Readman Prud’homme, Célia Wagenführer
Artistes : Frances Adair McKenzie, Marilou André, Maude Arès, Andrée-Anne Roussel, Nico Williams
Ancrages : Marc-Antoine K. Phaneuf
Entretiens : Aimée Lévesque (Anne-Marie Duquette) et Martin Dufrasne (Karine Bouchard)
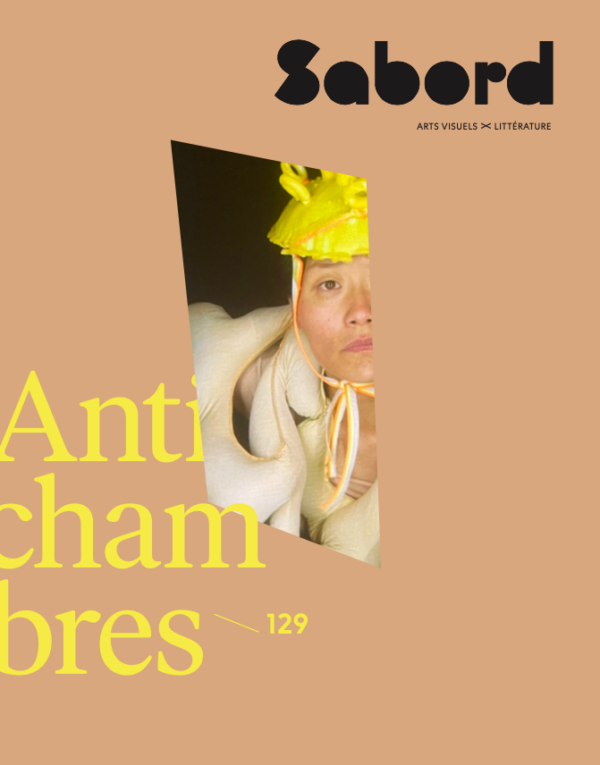
Espace intermédiaire, l’antichambre s’impose comme un passage obligé, une attente indéterminée. À l’inverse de l’intimité et de la sécurité qu’offre la chambre, elle est un lieu d’incertitude où tout peut advenir. On s’y questionne, on y erre, on y va et vient dans l’appréhension du futur proche. On tend à y tourner les idées en boucle, avancer-reculer, faire volte-face. De ce fait, on y crée scénarios et histoires, liens et amitiés.
Or les murs des antichambres sont faits de rumeurs et d’angoisses, d’espoirs et de deuils, de résignations. On s’y confronte au silence, à l’absence, à la nostalgie. Peu de portes les ouvrent : une pour entrer et une pour sortir. Mais en sort-on vraiment ?
Les auteurs et autrices de ce numéro proposent des versions multiples de cet espace suspendu. Entre les murs serrés d’une relation à soi – créative (Lafleur) ou physique (Boyer) – et à l’autre (Markovskaia, Robichaud), qu’elle soit amoureuse (Morro), familiale (Camirand) ou viscéralement amicale (Doucet), l’antichambre est un espace creux où les souvenirs côtoient les appréhensions (Dubé-Lavigne), où le temps se suspend pour mieux se réfléchir. On ne sait jamais tout à fait s’il se situe du côté du réel ou du rêvé (Kurtness), ou si même ces deux côtés sont bien distincts. On s’y rend en toute vulnérabilité, par choix (Brousseau) ou obligation (Lardeux), se prêtant alors au jeu d’autrui.
Pour les artistes du numéro, les espaces d’exposition et des projets mêmes deviennent des lieux hétérotopiques où sont susceptibles d’apparaître les potentialités. Dans ce non-lieu défini par une temporalité décalée, se jouent tout autant les affects de la fête foraine (Goyette Cournoyer) que les politiques institutionnelles et étatiques (Joumaa). S’y loge également le foisonnement des gestes de productivité et de répétition (Dufaux et Wendt), tout comme s’y tracent des gestes liés à l’écoute et à la riposte (Boudreau). Mais certainement, l’antichambre donne l’occasion de faire émerger des prises de conscience sur l’existence, à la fois physique (Brouillard) et numérique (aenl).
Auteur·rice·s : Rachel Boyer, Emmanuelle Brousseau, Fidélie Camirand, Léa Doucet, Ariane Dubé-Lavigne, J.D. Kurtness, Annie Lafleur, Anne Lardeux, Luba Markovskaia, Tom Morro, Geneviève Robichaud
Artistes : aenl, Olivia Boudreau, Josée Brouillard, Pascal Dufaux, Sébastien Goyette Cournoyer, Joyce Joumaa, Sarah Wendt
Ancrages : Klaus Scherübel
Entretiens : Mélikah Abdelmoumen (Anne-Marie Duquette) et Edmond Rochette Pelletier (Karine Bouchard)
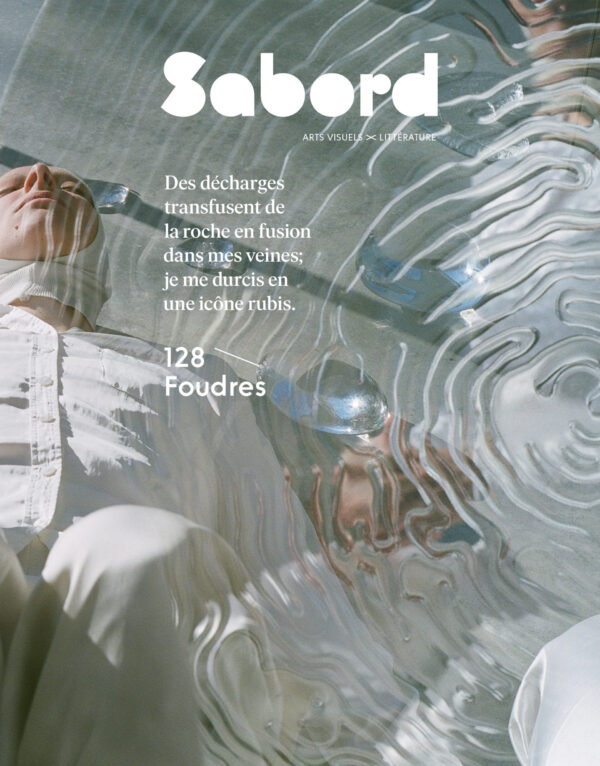
L’année du fourmillement et de la création à son état d’émergence se termine sur le foudroiement, sur cette manifestation du futur qui, en un éclair lumineux, transforme le regard sans possibilité de retour en arrière. Alors que la foudre n’existe en réalité qu’une fraction de seconde, elle génère par induction des transformations puissantes qui bouleversent l’ordre des choses. Sa présence est ainsi poursuivie par cet état modifié – du paysage, d’une personne, d’une relation – a posteriori de l’événement. Ce sont les cicatrices, les brûlures, l’énergie emmagasinée, mais aussi l’excitation, la fascination et l’appréhension qui témoignent que les foudres ont eu lieu, qu’elles étaient bien réelles et qu’elles pourraient se reproduire.
Mais l’orage, ce peut être aussi synonyme de renouveau. Pour Catherine Leroux, il est l’acmé d’une tension atmosphérique qui précède le retour à l’équilibre : « On vit les éclairs, la foudre, comme des attaques matérielles, comme des forces destructrices, mais en réalité c’est le rétablissement d’un équilibre, qui se révèle extrêmement énergisant et libérateur. » (p. 97) Et de cette énergie, il faut créer. Se laisser envahir pour canaliser. Et, plus tard, faire les choix nécessaires à l’œuvre. Trouver, à travers la forêt de ramifications lumineuses, celle qui saura porter le projet, le transpercer, le faire résonner longtemps.
Vient donc avec l’éclair le travail. Après le coup de foudre, l’éclair de génie, la mise à mort d’une partie de soi, il faut produire, à l’instar des électrons, protons et neutrons, contribuer au rééquilibre, tout en sachant que ce dernier ne durera pas. Car l’orage est intrinsèquement cyclique; il permet au vent de balayer les terres et les cieux, à la pluie de tomber, imbiber, abreuver, perler, s’évaporer, s’accumuler, voler, éclater de nouveau. Les foudres nous amènent à reconsidérer la création à travers le prisme du scientifique et du naturel, et surtout de l’humain. Qu’est-ce que la fulgurance à l’échelle d’une vie ?
Auteur·rice·s : Martine Audet, Jennifer Bélanger, Vicky Bernard, Valérie Forgues, Alizée Goulet, Félix Légaré, Meg Matich, Cristina Moscini, Malorie Yawenda Picard, Geneviève Rioux, Viviane Welter
Artistes : Philippe Caron Lefebvre, Charline Dally, Emma Waltraud Howes, Lynn Kodeih, Karine Savard
Ancrages : Maude Pilon
Entretiens : Catherine Leroux (Anne-Marie Duquette) et Andreas Rutkauskas (Noémie Fortin)

Sororité. Si le terme figure depuis des siècles dans les dictionnaires, il a fallu attendre le mouvement féministe des années 1970 pour qu’il soit usité et conceptualisé. La sororité se situe « hors de la foi chrétienne, de la structure familiale, de toute domination masculine. Une relation horizontale, sans hiérarchie ni droit d’aînesse. [...]. Un rapport de femme à femme, ni fille ni mère, égalitaire », résume Chloé Delaume en introduction à Sororité (2021).
La sororité peut être un choix anticapitaliste dangereux : elle relègue le pouvoir individuel au second plan pour nourrir la force collective. Elle est un combat constant contre la tendance qui règne à faire disparaître les femmes : « il s’agit d’imposer cette voix collective, en la considérant comme une manière d’échapper à la disparition. [...] Elle s’impose comme force tranquille et intranquille, constante, qui part de la noirceur pour rejoindre la lumière », explique Mikella Nicol dans son mémoire (2018). La sororité est à la fois une réaction face aux violences imposées aux femmes et un mouvement d’émancipation, de légitimation et de refus de tomber dans la fosse. Être reconnue par-delà le système qui asservit, s’inventer une place par résonance dans un écosystème qui se fonde sur la disparition. La sororité comme ultime façon d’apparaître.
Les textes et les œuvres de ce numéro construisent des moments, des instants de sororité qui jouent des limites mêmes de la notion. Ils réactualisent, voire déplacent les lieux communs pour réfléchir à des formes de sororité actuelles, représentatives des enjeux relationnels qui engagent dans des dynamiques parfois de division, de confrontation, de tension, parfois d’allers et retours, mais toujours dans une volonté d’explorer à la fois les possibles d’une résistance et d’une communauté d’appartenance.
Avec la plus grande des vulnérabilités, les autrices et les auteurs de ce numéro plongent dans la sororité par une multitude de brèches. Les artistes, quant à elles et eux, semblent penser la dissension, illustrer une désolidarité qui prend forme au cœur même des structures sororales souhaitées et accomplies. Des communautés de corps mouvants s’enchevêtrent pour exprimer des formes alternatives de pouvoir.
Auteur·rice·s : Juliette Bernatchez, Irma Bouchard, Sarah Boutin, Simon Brown, Laurence Gagné, Kari Guillemette, Véronique Guyaz, Catherine Anne Laranjo, Judith Lefebvre, Jonathan Reynolds, Laurence Veilleux
Artistes : Kimberley de Jong, Lindsay Katsitsakatste Delaronde, Geneviève Thibault, Eric Tschaeppeler, Anouk Verviers, Leila Zelli
Ancrages : Laia Moreto Alvarado, Eva Quintas
Entretiens : Mikella Nicol (Anne-Marie Duquette) et Anne-Marie Proulx (Noémie Fortin).

La toute première phase est celle où dans le tumulte ambiant, la cacophonie des voix et des bruits, l’œuvre encore embryonnaire se prépare, se développe, se nourrit. Le projet, tranquillement, trouve sa matérialité, son élan. Au milieu du fourmillement de nouvelles données – souvent contradictoires – qui s’imposent, le créateur et la créatrice attrapent au vol matériaux, parentés, impulsions et doutes pour trier les possibles et délimiter le champ de création. Désormais, penser au pluriel, au-delà de la singularité : pour des mondes possibles.
Incubation, bifurcations, discussions animées : cette étape de recherche et de choix représente une temporalité autre, à la fois passionnante et angoissante, assurément vertigineuse. Car au cœur de l’effervescence, l’artiste d’aujourd’hui cherche par une force centrifuge le débordement, l’éclatement, le décentrement, l’horizontalité, le décadrage. Les formes artistiques et littéraires, affranchies de leurs supports attendus, « rendent indistincts le dedans et le dehors, l’acteur·rice et la personne spectatrice, la production et la publication » (Ruel, 2016). Mettre à nu la création et sa conceptualisation jusqu’à ce qu’elles deviennent visibles, tangibles, observables, atteignables.
Dans un effet d’aller-retour, le chaos sonore renvoie pour les auteurs et les autrices de ce numéro au cœur, au centre, au soi. De la solitude subie à celle choisie, des espaces clos de la chambre ou de la salle du métier à tisser aux non-lieux de la rame de métro, de la rue et des corridors d’hôpitaux, le brouhaha engendre une occasion forcée ou suggérée de plonger en soi, de revêtir une cloche semi-transparente, scaphandre, à travers laquelle percevoir en décalage le monde extérieur, fait de machines et de cris, tout en tendant l’oreille vers soi, vers la douleur d’un deuil, l’affranchissement, l’éclatement réprimé.
S’agit-il de créer son propre brouhaha pour l’inscrire dans le monde ? Ou de contrôler le brouhaha pour une société plus démocratique en devenir ? S’agit-il de sortir des éléments de ce brouhaha pour mieux (se) comprendre ?
Auteur·rice·s : Joël Bégin, Inès Coville, Sarine Demirjian, Violaine Forest, Marie-Ève Kingsley, Benjamin Lachance, Virginie Lachapelle, Maude Lafleur, Alix Paré-Vallerand, Maxime Poirier-Lemelin
Artistes : Rémi Belliveau, Eltractor, Julie Faubert, Anahita Norouzi, Sandra Volny
Ancrages : Monique Juteau
Entretiens : Martine Delvaux (Anne-Marie Duquette) et Loïc Chauvin (Karine Bouchard)

Afin de souligner ses 40 ans en 2023, Le Sabord prépare un triptyque festif pour ses numéros 123 à 125!
Post- – signifie après – mais après avec un tiret – doublement après – réfléchir à après-l’après – ce que ce numéro propose – en ce 40e anniversaire – s’intéresser à ce qui vient ensuite – qui succède au maintenant – à l’honneur dans le 124 | carrefours – qui précède d’autant plus l’antérieur – aux premières loges dans le 123 | rhizomes –
Cette fois aborder ce qui survient par-delà – et ne pas oublier de questionner le tiret – le trait d’union se projette comme une flèche – vers l’ultérieur, l’avenir, le re(commencement) – les possibles – ce qui se situe de l’autre côté d’une ligne donnée – nouvelles célébrations du futur – comme l’exposition Archiver le futur autour de laquelle ce numéro se déploie – en autant de pointillés artistiques – fouiller les archives pour en faire ressortir l’inédit, anéantir – par le feu – des éléments multiples – des pans du passé – faire pousser les horizons – tantôt la postérité, tantôt le posthume – le « post-matière » – mais toujours des projections inventives
Sur des post-it écrire – post-industriel – post-classique – post-féminisme – post-homérique – le post dans postures – également dans – post mortem – ex post – postuler – imposture – a posteriori – retour aux lendemains – aux horizons qui destinent, prédestinent – à la sérendipité – un numéro dont les œuvres sont telles les facettes d’un kaléidoscope de prochains – interroger ce qui adviendra – le suivant – subséquemment –
Ne pas oublier de questionner le tiret
Auteur·rice·s : Marina de Seta, Julie Dugal, Anne-Marie Duquette, Ralph Elawani, Isabelle Gaudet-Labine, Mimi Haddam, Bianca Joubert, Chloé Laduchesse, Gabrielle Morin, Ariane Tapp
Artistes : Mathieu Grenier, Suzanne Kite, Virginie Laganière, Shanie Tomassini, Quentin Vercetty
Ancrages : Karoline Georges
Entretiens : Dominique Mousseau

Afin de souligner ses 40 ans en 2023, Le Sabord prépare un triptyque festif pour ses numéros 123 à 125!
Le second numéro du triptyque anniversaire, le no « 124 | carrefours », s’attarde au temps présent. Il arpente les avenues du maintenant, les conjonctions et le fugace qui se déploient en autant d’artères actuelles et vibrantes. Nous vous invitons à investir les voies qui s’ouvrent aux croisements des idées et de l’horizon des choix, l’ici en suspens.
Carrefours, du latin quadricus, qui a quatre fourches : endroit où se croisent autant de chemins.
CARREFOURS. S’engager aux limites de soi. Du territoire. Dans l’entre-vie. Renaître en bifurquant. Choix entre maintes possibilités. Être à un carrefour. Carrefour d’opinions, d’échanges. Entre-deux – entre quatre – quelquefois propices à la magie. À la fourche des ans, des fenêtres navales, des 160 saisons, du post-. Un terre-plein central. Un nœud pour prolonger les rhizomes vers l’avant. Mais surtout, une invitation à nous rejoindre au confluent de cet anniversaire.
Auteur·rice·s : Raphaëlle B. Adam, Chantal Doris Carignan, Ariane Gélinas, Anthony Lacroix, Hélène Laforest, Tina Laphengphratheng, Samuel Lapierre, Joanie Lemieux, Andrea Moorhead, Ève Nadeau, Laurence Primeau, Rosalie Trudel
Artistes : Mathieu Cardin, Kuh Del Rosario, Arkadi Lavoie-Lachapelle, Emanuel Licha, Enric Llagostera, Victoria Stanton
Entretiens : Mylène Durand

Afin de souligner ses 40 ans en 2023, Le Sabord prépare un triptyque festif pour ses numéros 123 à 125!
Le premier numéro de la série, « 123 | rhizomes », délie ses racines dans le passé, les archives, les ancrages nécessaires. Il vous invite à explorer l’amont et le jadis, à aborder l’antérieur et, parfois, l’immémorial. À débusquer les réseaux souterrains de sens, de connexions; à comprendre les origines plurielles de l’avant, les bourgeons à éclore.
Rhizome : « ce qui est enraciné. » Le rhizome ne pousse ni vers le ciel ni vers les souterrains ne s’enlise pas dans les humus froids non il étire ses tiges au même niveau que lui horizontales.
Artistes, autrices et auteurs taxinomisent ce numéro en un réseau croisé où le présent ne domine pas le passé mais cohabite avec lui
Mobile
Sans hiérarchies
Des florescences multiples s’avèrent possibles
sans cesse se transformer antérieurement
nous serons la tige la bouture le nénuphar
le noyau n’est pas celui que nous pensons
Auteur·rice·s : Marc-Étienne Brien, Mathieu Croisetière, Félix-Antoine Désilets-Rousseau, Monique Juteau, Claude La Charité, Annie Landreville, Annabelle Moreau, Maude Nadeau, Éric Roberge, Karolann St-Amand
Artistes : Geneviève Baril, Anne-Marie Bouchard, Denis Charland, Isabelle Gagné, Katherine Melançon, Michaëlle Sergile, Manon Sioui, Sanaz Sohrabi
Entretiens : Guy Langevin (Karine Bouchard)

Points de suture, suturer : ce qui guérit après avoir été blessé. Pour son 122e numéro, Le Sabord, fil à la main, aborde le thème du soin. Auteurs, autrices et artistes remontent aux origines du terme latin, qui signifie « couture ». Ils et elles montrent comment l’on peut rapiécer la chair, panser ses entailles, témoignent de la poésie de la suture d’un fruit, d’une coquille. À l’opposé de la déchirure, elles et ils recousent le fil des cicatrices, proposent des maillages comme autant de connexions.
Auteur·rice·s : Fiorella Boucher, Simon Brown, Stéphanie Filion, Marie-Ève Francoeur, Flavia Garcia, Clara Lamy, Tina Laphengphratheng, Alex McCann, Julia Pawlowicz, Nana Quinn, Annie Tenaglio
Artistes : Sarah Chouinard-Poirier, Jannick Deslauriers, Duo Demi-mesure, Ahreum Lee, Chloë Lum & Yannick Desranleau, Eve Tagny
Entretiens : Alice Zerini-Le Reste (Karine Bouchard) et Michel Jean (Ariane Gélinas)